
Rencontre avec Valentin Gendrot, le journaliste qui a infiltré la police
C’est autour d’un café que nous retrouvons Valentin Gendrot, un homme sûr de lui, humble et discret mais pourtant rempli de savoir sur la méthodologie journalistique. Après avoir réussi le concours de la police, il infiltre cette institution et en ressort avec un travail de terrain précis, factualisé et choquant dans la froideur et la trivialité des expériences vécues. Si par la suite de cette interview vous voulez en savoir plus, renseignez-vous sur le livre « Flic ». A travers le sujet clivant de la police et de ses violences, Valentin cherche à faire le travail de neutralité que doit faire un journaliste. Un exemple pour la profession avec un recul qu’il est très rare de trouver dans le monde médiatique traditionnel.
Tout d’abord, pourquoi rentrer dans cette institution et pas une autre, comme l’hôpital ou un complexe militaire par exemple ?
Déjà ce n’est pas la première, j’en ai fait déjà 6 avant, donc c’est la 7éme. L’idée de faire de l’infiltration, ça date de quand j’étais en école de journalisme, à Bordeaux. A cette époque-là, Florence Aubenas sortait « Le Quai de Ouistreham ». Moi ça m’a vachement interpellé, je ne connaissais pas cette façon de faire du journalisme en infiltration. Puis après j’ai déroulé la pelote, on va dire.
C’est une méthode journalistique qui existe depuis le 19ème siècle, c’est pas nouveau. Le première, à ma connaissance, c’est Nellie Bly, qui a écrit, « 10 jours dans un asile ». Elle s’est fait passer pour une malade mentale et a réussi à faire fermer l’hôpital où elle était. Donc ça permet de faire bouger les choses. Aujourd’hui c’est beaucoup plus dur de faire bouger les lignes, mais en tout cas, ça permet de montrer au grand public ce qu’il ne voit jamais. Tu apportes des éléments nouveau et une démarche inédite.
Pourquoi j’ai inflitré la Police, parce que c’est une sacrée question la Police Française. Les violences policières, le côté impunité des flics. C’est aussi d’un autre côté le mal-être policier avec une condition de travail dégradée, le suicide dans la police, tous les ans il y en a beaucoup. C’est un métier qui est particulier, car tu fais un boulot où tu es quand même représentant de l’état et il y a une partie de la population qui te déteste. C’est quand même étrange comme situation.

Comment se passe ce phénomène d’aliénation, dans le sens où ton cerveau switch. T u deviens flic toi-même avec l’arme et l’uniforme ?
Déjà c’est avec l’habitude. Je sais pas si ça te le fais, mais quand tu arrives à Paris par exemple, les premiers SDF, ou les gens qui font la manche, ça te choque. J’ai toujours envie d’aller acheter une baguette de pain, donner une pièce. Mais après quelques mois ou années, tu ne les calcules plus ces gens, c’est terrible. Il y a le phénomène d’habitude. Pour ce cas précis de la police, je peux faire un parallèle. Les premières fois que des femmes venaient déposer plainte pour violences conjugales, moi j’étais au taquet, sur le qui-vive. Puis tu te rends compte que tu t’habitues. Tu as pareil avec l’utilisation des mots. Le terme « bâtards », souvent utilisé pour désigner les jeunes hommes noirs, d’origine arabe ou les migrants, au départ c’est choquant et extrêmement raciste et puis tu t’étonnes de l’utiliser par la suite.
Et puis c’est aussi ma méthode d’infiltration. Pour moi c’est comme prendre un train en marche. Je suis pas là pour faire de vague. Je suis simplement là pour montrer comment ça se passe de l’autre côté. Pour essayer de comprendre et d’expliquer, je trouve pas ça intéressant de juste dénoncer les violences policières, c’est pas suffisant. C’est plus intéressant de rentrer dedans, comme ça tu le racontes plus facilement, avec plus de sincérité. Mais pour aller plus loin dans les différents profils de policier, il aurait fallut aller plus loin encore. Sauf que moi mon plan de vol c’était 3 mois en école, que j’ai faite à Saint Malo, 6 mois dans un commissariat et 15 mois ailleurs. Au moment où je me suis dit que j’avais tenu mon engagement, je me suis dit que j’étais cramé, j’en pouvais plus de cet univers de violence. Le mensonge aussi, c’est fatigant. Donc j’ai rempli mon défi personnel et je me suis barré.
Ton livre, comment tu l’as écrit? Pendant l’expérience ou par la suite ?
Tous les jours je prenais deux heures de note, c’était une routine après le travail. J’écrivais tout ce que je faisais dans la journée. Et puis évidement quand j’ai écrit le livre, je me suis basé sur ce que j’avais écrit et j’y ai ajouté d’autres impressions.
L’idée c’était de publier en mai, donc je suis sorti du commissariat en août. Je voulais prendre 2 semaines de vacances et par la suite écrire. Bien sûr, il y a eu plusieurs versions, c’est toujours ça dans le monde de l’édition. Par exemple, il y a tout un pan sur « l’infirmerie psychiatrique, qu’elle place on lui accorde? » qui a fait partie des discussions pour les variations dans les versions. Et puis on a décalé la publication à septembre avec le confinement. Entre-temps, la question de violences policières a pris un dimension mondiale avec par exemple George Floyd. Donc on s’est servi de cette actualité très chaude pour la publication.
Comment tu réagis au fait qu’une partie des gens qui connaît ton livre te catégorise comme – je cite – « un vendu » qui « défend la police ».
Je pense que ces personnes n’ont pas dû lire le livre pour tenir ce genre de propos.
Tu sais, j’ai aussi entendu l’inverse : « c’est un livre anti-flics ».
Moi je veux bien discuter avec les gens, mais qu’ils aient au moins lu le livre et qu’ils aient des critiques constructives. Sur une démarche comme ça, c’est normal. Puis ce n’est pas un livre qui défend ou attaque la police. Je suis pas là pour faire de l’idéologie. Je fais un reportage. Mes deux grandes questions sont les deux grand tabous de la police française : le mal-être policier et les violences policières. Mon avis sur la question, on s’en fiche, c’est trop réducteur. Mais la critique constructive est intéressante dans le sens où elle amène au débat. La question de la limite par exemple: « jusqu’où un journaliste peux aller dans une infiltration? » ça c’est une question à soulever. De manière générale, quand un livre comme ça sort, c’est la question qui revient, et c’est légitime.
Il y a aussi la question de la sélection policière qui est à poser. Je suis passé comme ça. J’ai passé le concours, comme tout le monde, et à aucun moment on m’a dit, « non non, vous, vous ne pouvez pas, car vous êtes journaliste. ». Il y a quand même des trous dans la raquette.

Comment après ce genre d’expériences, tu te reconstruis, en terme d’identité ?
Tout d’abord, je ne suis pas détruit, j’ai n’ai pas eu à me reconstruire.
Tout à l’heure, je parlais de Florence Aubenas. Il y a une interview qu’elle donne après, où elle raconte qu’il faut toujours être soi-même. Il ne faut pas jouer un rôle, ne pas être un acteur car au bout d’un moment, ça ne va plus marcher. Tu peux te faire piéger, ou te piéger toi-même. Il y a trop de moments comme ça, malgré toi.
La bonne stratégie pour une infiltration, c’est juste de masquer ce que tu veux masquer. A aucun moment le mot « journaliste » apparaît sur mon CV, tout le reste je peux en parler. Il faut partir du réel et déformer quelques paramètres : tu gonfles certaines choses pour masquer le journalisme.
Est ce que parfois ta méthodologie de travail est rentrée en opposition avec ce que tu as appris en école de journalisme ?
Évidemment. En école de journalisme, on n’apprend pas à faire des infiltrations. On apprend à faire des articles, de la radio et de la TV.
Après, l’école où j’étais à Bordeaux était un peu particulière car déjà le recrutement est particulier. On était 36, tu avais 5/6 personnes de ma promo qui avaient fait science po. Normalement, dans le journalisme, c’est souvent l’inverse, la majorité vient de science po, et ils sont déjà formatés dans le moule. Nous, on était de socio, de psycho et d’histoire, on est tous issus de classe moyenne et pas de classe aisée. On avait un prof qui nous donnait des cours de critiques de médias, on voyait des choses qu’on ne voyait pas dans d’autres écoles.
Mais évidemment, tu ressors extrêmement formaté, on a les intonations et les mots des grands médias. Tu n’apprends pas dans une école mais sur le terrain. La meilleur façon d’apprendre c’est par la presse locale, car tu touches à tout. Après, il y a des contraintes : tu restes en surface, car tu fais 3 ou 4 articles par jour. Je suis d’un naturel timide à la base, et ça m’a appris à aller vers les gens et à améliorer mon aspect relationnel.
Ca te sert à quoi de faire des interviews comme ça, c’est le besoin de transmettre ?
C’est de la promotion surtout, quand tu sors un livre, tu passes toujours par une période de promotion, tu es obligé. C’est aussi pour que les personnes qui lisent l’interview puissent s’emparer du débat et puissent être choquées par certaines choses. Comment j’ai pu passer aussi facilement le concours ? Pourquoi après 3 mois de formation seulement tu as le droit de porter une arme ? Cela permet aussi de montrer que des violences policières passent sous le radar, malgré le fait que la police soit contrôlée. Que des migrants se font tabasser dans des fourgons, choses que j’ai pu voir 3 ou 4 fois, ou bien que des personnes soient frappées en garde à vue. Que les moments de violences policières ne sont jamais écrits sur les logiciels de la police ou ne passent jamais sur les ondes de la police.
Ça passe par en dessous, et comme j’étais dedans, je peux le montrer.
Le monde de la police est un monde extrêmement violent. Le terme de « violences policières » est-il la bonne expression sachant que « violence » et « police » vont souvent ensemble. Tous ce que tu fais quand tu es policier est violent. Tu te lève à 4h du mat’, tu vas dans un appart ou quelqu’un est mort, tu es confronté à ça.
Le mal-être de la police concerne toute l’institution, c’est quelque chose qu’il faut comprendre. La question de bavure policière, c’est une minorité, et c’est toujours les mêmes, ils ne sont jamais sanctionnés. Il y a aussi la loi du silence dans la police, si tu dénonces, tu risques d’être mis de côté, d’être ostracisé, être victime de brimades.
Le lien de confiance entre la police et la population est totalement brisé. Mais je pense que c’est surtout le problème de l’IGPN qui n’est pas indépendant. Ce sont des policiers qui enquête sur des policiers. L’une des solutions serait de faire comme les anglais, de réformer l’IGPN. Quand tu réformes l’IGPN, tu amènes de l’indépendance, donc les policiers sont sanctionnés plus facilement. Dès le moment où les policiers qui font n’importe quoi sont évincés, le lien de confiance avec la population se restaure. Ils deviennent des justiciables comme tout le monde, tu fais baisser la température.
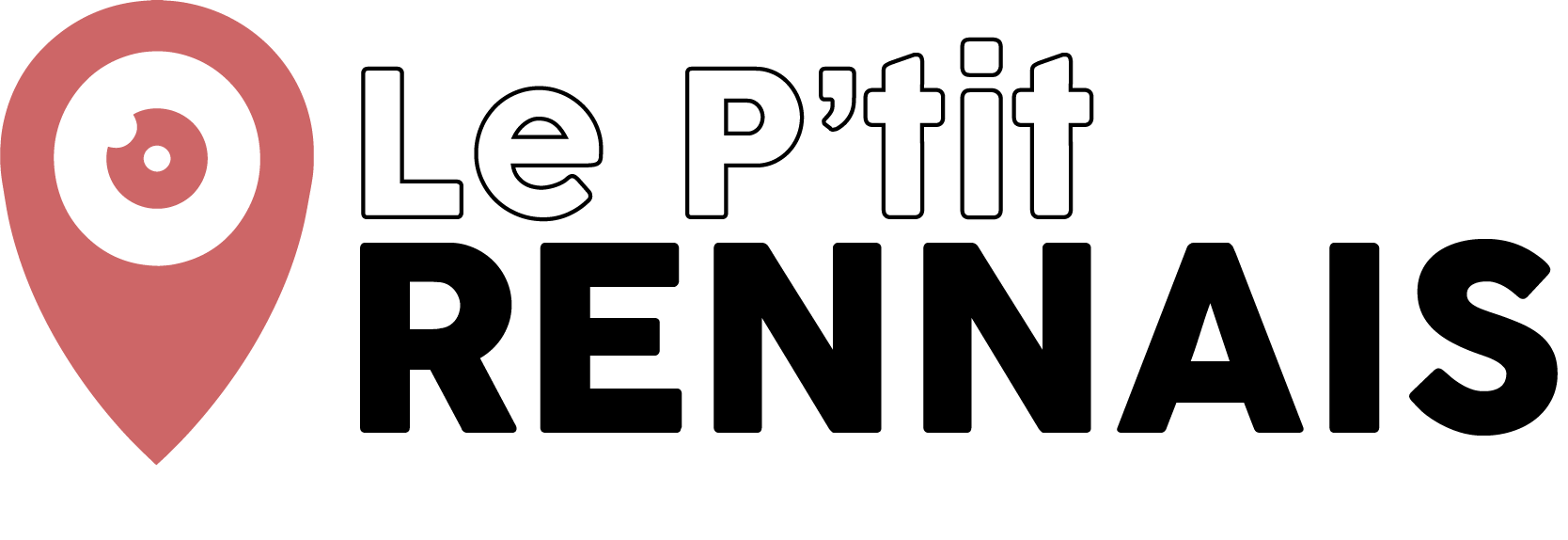




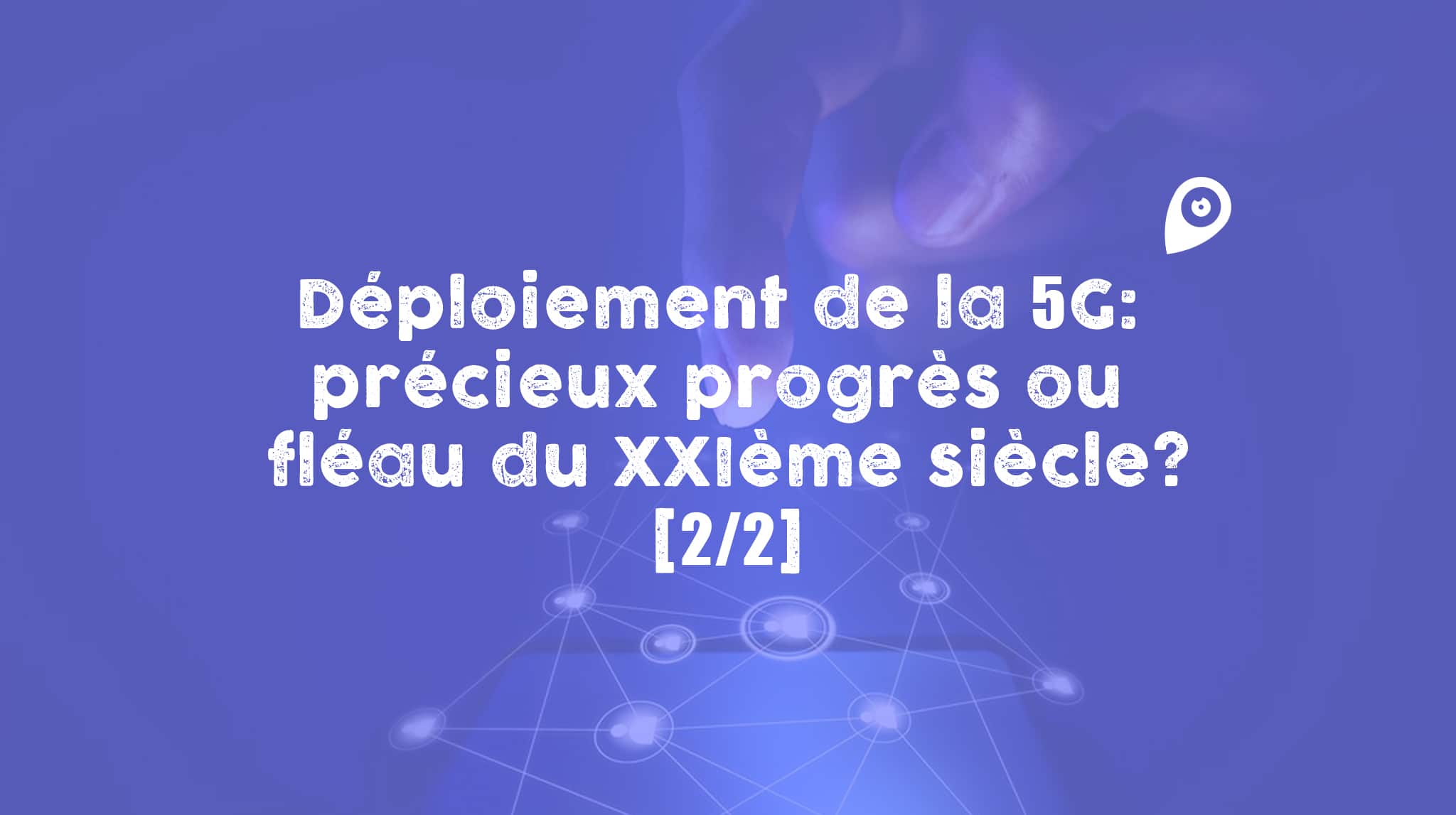
No Comments